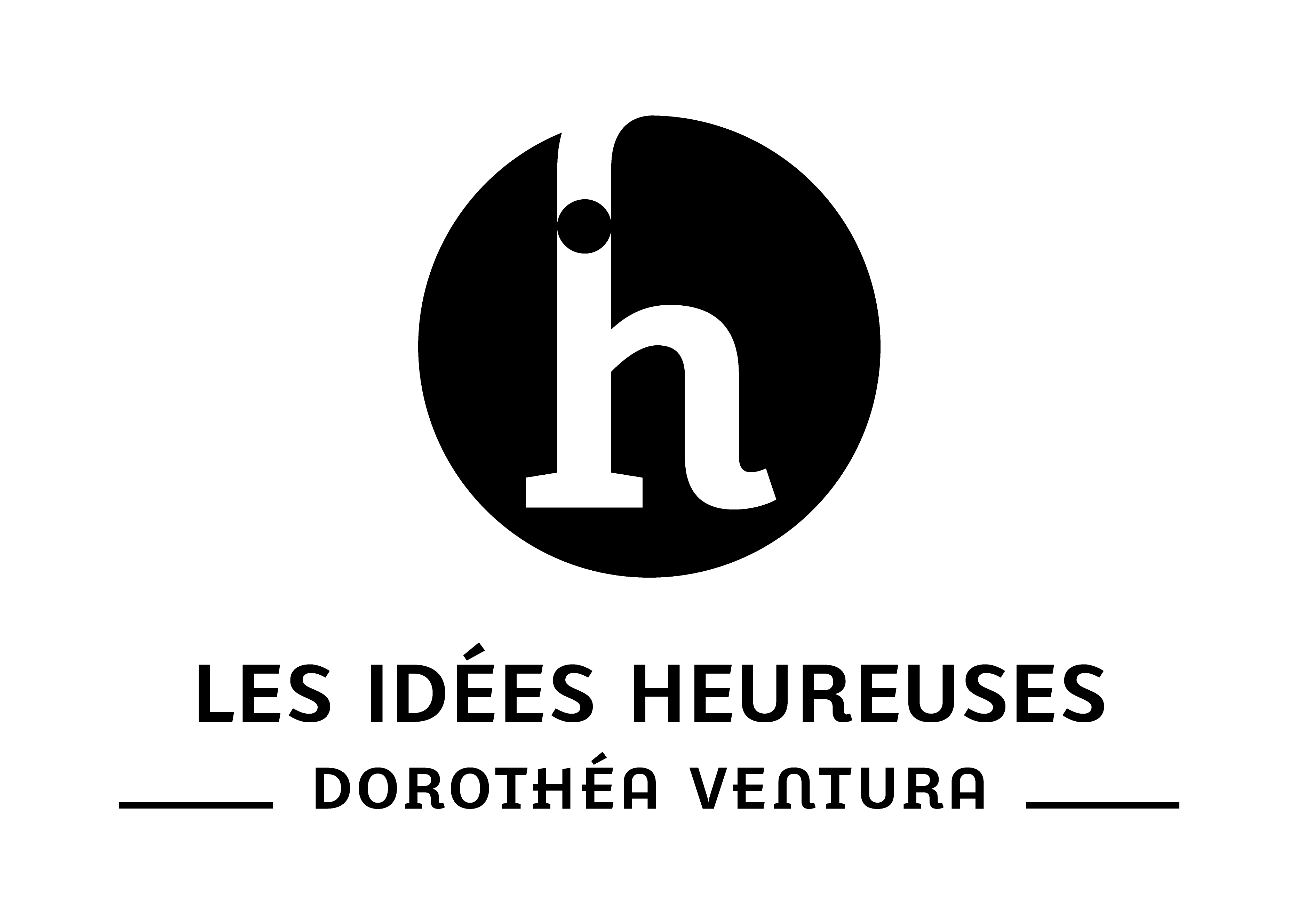La Musique dans les missions de Ville-Marie et du Lac des Deux-Montagnes sous le Régime français

La Musique dans les missions de Ville-Marie et du Lac des Deux-Montagnes sous le Régime français
- L’EDUCATION MUSICALE DANS LES MISSIONS DE LA NOUVELLE-FRANCE
Un aspect méconnu de l’histoire de la musique et, aussi, de celle de la Nouvelle-France, est la pratique musicale en langues autochtones dans les missions. Bien que la légitimé de la christianisation des Amérindiens à l’époque coloniale soit sans cesse remise en cause, il me semble important d’en témoigner par le biais de la musique. Au concert de la Passion du 15 avril à 15 h, nous présenterons – dans la partie consacrée au missionnaire théologien et prêtre sulpicien, Vachon de Belmont (1645 – 1732) du plain-chant en mohawk et en algonquin, issu de la tradition de la Mission du Lac des Deux-Montagnes.
L’éducation musicale et la musique sont omniprésentes en France au 17e siècle, dans toutes les couches de la société, tant dans la sphère domestique que dans la sphère spirituelle. Dans les couvents comme à l’église – alors fréquentée par l’immense majorité de la population – les offices et les messes sont chantés.
Pour les missionnaires français de la Nouvelle-France, dont le but est d’évangéliser, il est donc tout naturel de le faire en musique. La musique est un puissant outil d’évangélisation, d’autant plus que la musique européenne – comme les arts visuels qui émerveillaient les Amérindiens – constitue l’un des objet de fascination les plus puissants agissant sur l’imaginaire autochtone.
POUR EN SAVOIR PLUS
À la Mission du Fort de la montagne, Vachon de Belmont enseigne le catéchisme et apprend aux Autochtones le chant et la langue française. L’apprentissage se fait d’abord de manière orale, à l’oreille. Le plain-chant est constitué des mélodies simples, toujours monodiques (à une voix musicale) et les textes sont syllabiques pour en faciliter la mémorisation par les fidèles. Le missionnaire est le seul capable de lire la musique. La mémoire auditive joue donc un rôle central dans l’apprentissage . Vachon de Belmont, cela est attesté, accompagne le chant religieux en langue indigène au luth et peut-être aussi à l’orgue car il fera venir de Paris son petit orgue de bois, avant 1705.
De très nombreux témoignages d’Européens attestent du talent naturel des autochtones pour le chant et pour la musique. Je n’en cite qu’un parmi des plusieurs dizaines, livrés seulement en Nouvelle-France, celui du Père Enjelran, dans une lettre de 1676. Il est le directeur jésuite de la mission abénaquise de Sillery: « On est ravi d’entendre les divers chœurs d’hommes et de femmes chantant pendant la messe et les vêpres. Les religieuses de France ne chantent pas plus agréablement que ces femmes sauvages et, universellement, tous les sauvages ont beaucoup d’aptitude et d’inclinaison à chanter les cantiques de l’Église qu’on a mis à leur langue. »
Cette réputation du talent musical naturel et de la beauté des voix des autochtones a perdurée jusqu’au début du XXe siècle, comme en témoigne l’historiographe des Hurons, Lionel Lindsay, qui écrit, vers 1900, qu’ils méritent encore leur réputation de chantres.
- LES MISSIONS DE L’ÎLE DE MONTREAL ET DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
Je livre maintenant ici quelques informations sur les deux missions de l’île de Montréal aux 17eet 18eet sur celle du Lac des Deux-Montagnes qui leur succédera et qui existe encore de nos jours.
C’est vers 1670 qu’une terre fertile au pied de la montagne est octroyée par les Sulpiciens, alors Seigneurs et propriétaires de l’Île de Montréal, à un groupe de la mission de Laprairie, composée d’Autochtones rescapés des massacres de Huronnie en Ontario – c’est là qu’avait été martyrisé, en 1649, le Père Jean de Brébeuf. Ces Autochtones christianisés y installent alors leur hameau.
Pour les autochtones catholiques, venir s’installer à proximité des Français ne constitue pas une soumission. Ils ne se considèrent pas comme réfugiés. En effet, ils habitent dans leurs propres villages, en y cultivent leurs champs et s’activent à leurs occupations traditionnelles ; ils sont autonomes des colons Français et ont leurs propres dirigeants. Ils sont des alliés de la France ; on connait d’ailleurs leur importance vitale pour la colonie. Le mohawk et l’algonquin sont les seules langues en usage dans la communauté.
Quelques années plus tard, en 1680, le prêtre, missionnaire et musicien François Vachon de Belmont va construire, jouxtant le village amérindien entouré de palissades, un fort, qu’il dessine – il est aussi architecte – entouré de quatre tours de pierres et d’un mur, à l’intérieur duquel on trouvera évidemment une église. Il aménage agréablement les lieux avec une basse-cour, un colombier, un vivier, un verger, une vigne et même, une fontaine. Deux des quatre tours rondes en maçonnerie de ce fort sont encore visibles aujourd’hui, juste derrière les murs du Grand Séminaire de Montréal, sur la rue Sherbrooke près d’Atwater, du côté nord. Ce sont des vestiges précieux de notre histoire.
La mission du Fort de la Montagne rassemble le village amérindien, d’une part, et le fort en question, nommé « Fort des Messieurs de Saint-Sulpice », d’autre part. C’est l’une des plus anciennes missions autochtones de la région de Montréal, et la 1ère de l’ile.
POUR EN SAVOIR PLUS
Les témoignages de l’époque notent la foi catholique très forte des autochtones de la communauté. Les Iroquois de la mission s’auto-désignent premièrement et communément comme des « Kariwiioston, i.e., « des Croyants ». Le seul emprunt notable fait aux Français, c’est, en effet, la religion. Les offices religieux se déroulent dans l’église du fort, exclusivement en langues autochtones, contrairement aux paroisses françaises où le latin est utilisé.
En 1694, après un feu qui détruit le fort de la mission de la Montagne la première mission déménage vers une seconde mission et s’installe à partir de 1692, au Sault-au-Récollet. Cette seconde mission porte le nom de Fort-Lorette, Skawenati pour les Autochtone (« de l’autre côté de l’île ») . C’est en 2017 qu’on en découvre les vestiges tout près de l’actuelle église de la Visitation, la plus ancienne église de Montréal toujours en activité, construite vers 1750 autour de ces vestiges. Jouxtant le Fort Lorette se trouvait – selon le modèle du Fort de la Montagne – le dernier village autochtone de l’Île de Montréal.
Ce ne sont pas les Autochtones qui ont initiés ces déménagements de leurs villages qui ne leur plaisent guère, mais plutôt les Sulpiciens et ce, pour des raisons de possession de territoire peu édifiantes qui les avantagent financièrement. Élaborée à l’époque du Fort de la Montagne, cette stratégie malhonnête d’encourager les Autochtones à mettre en valeur le territoire et à défricher la terre pour ensuite les inciter à partir pour y installer des colons français fut reproduite au Sault-aux-Récollets, puis au Lac des Deux-Montagnes. Ne possédant que la parole des Sulpiciens et aucun contrats écrits, la revendication territoriale des Mohawk a engendré la crise d’Oka de 1990.
III. LA MUSIQUE LITURGIQUE DES MISSIONS
Plusieurs nations amérindiennes possèdent encore un répertoire de chants religieux catholiques dans leur propre langue dont la musique est une adaptation de mélodies grégoriennes ou des airs de cantiques français.
En 1865 est publié le « Livre des Sept nations ou Paroissien Iroquois auquel on a ajouté, pour l’usage de la mission du Lac des Deux-Montagnes, quelques cantiques en langue algonquine ». On le retrouve aisément sur BAnQ numérique.
La musique qui y est imprimée reprend la tradition établie au début de la colonie que j’ai évoquée. La prolongation dans le temps des traditions orales aussi anciennes que celles du 17e siècle est un phénomène que j’ai pu observer maintes fois en musique dans des publications du 20e siècle.
Plusieurs membres de diverses communautés autochtones pratiquent toujours la religion catholique et le chant liturgique y tient une place de choix dans les cérémonies. La qualité des chantres et des organistes est évidente en plusieurs lieux. Une visite dans les églises des réserves lors d’une fête religieuse d’importance chez les Mohawk de Kahnawake, chez les Abénaquis d’Odanak – où le chant liturgique a été particulièrement été développé sous le Régime Français et qui conserve le plus important manuscrit de musique française du 17e siècle en langue autochtone en Amérique du Nord – ou chez les Hurons-Wendat à Wendake permettent d’observer le métissage culturel entre les européens et les Premières Nations qui ont conservé des traits de leurs culture respectives, telle les processions avec des plantes sacrées fumantes, comme la sauge ou le tabac, autour de la croix.
Au Concert de la Passion, vous entendrez du plain chant pour la Semaine Sainte, soit, pour le Dimanche de la Passion, l’hymne des Vêpres, Vexila regis prodeun / Tsi Ienontarastha : Iesos, tekonnoronk8anions ; pour le Jeudi Saint, l’Antienne pour le lavement des pieds Ubi caritas et amor / Tsinasalcositohare : Taete8atatenon8ehak et, pour le Vendredi Saint, l’hymne pour le Chemin de croix : Stabat Mater dolorosa et les Impropères pour l’Adoration de la Croix,
Improperium (Popule meus) / Ron8aiatanentaktonn.
Nous remercions mesdames Donna Kanerahtenha:wi Jacobs et Annette Kaia’titakhe Jacobs de la communauté de Kahnawake pour la traduction et l’enseignement de la langue Mohawk.
Ce texte utilise des informations provenant de trois (3) articles : « Structure solfégique et tradition orale dans quelques missions de la Nouvelle-France » du professeur Paul-André Dubois, Revue Rabaska, Volume 5, 2007 (pages 7-35) ainsi que « Les Seigneurs sulpiciens, les Autochtones et Fort Lorette » et « Vivre à la mission de la Nouvelle-Lorette » de l’anthropologue Alexandre Lapointe, Bulletins de la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville, no 7 (mai 2020) et no 8 (novembre 2020).